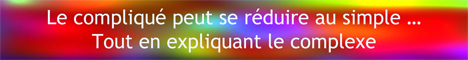Les croyances concernent ce que leurs adhérents considèrent comme des vérités, mais nombre d'entre elles sont en fait non décidables, c'est-à-dire ni démontrables, ni réfutables … ce qui explique que pour un même questionnement les réponses puissent être multiples.
Une telle croyance, qui peut s'exprimer sous la forme d'un dogme, doit cependant rester conforme à la logique et à la science. Dans le cadre d'une théorie proposant plusieurs croyances, il faut aussi que celles-ci soient cohérentes entre elles.
Ces croyances sont alors des convictions qui sont trop souvent présentées comme des certitudes.
D'autre usent de mot que l'on ne définit pas, ce qui laisse la porte ouverte à ce que l'on veut ou presque que veut dire engendré ou procède ?
Autre exemple : le concile de Trente reconnaît la valeur de la Tradition, mais n'indique pas en quoi elle consiste, ou Vatican I qui énonce l'infaillibilité pontificale lorsque le pape s'exprime "ex cathedra" sans préciser les conditions et caractéristiques de cette condition. C'est après coup que des théologiens non infaillibles (!) ont précisé des critères.
Cohérence des dogmes …
- Détails
- Version n° 3 du 22-03-2024
Cela ne fait pas 2000 ans que l'homme fait de la théologie, s'interroge et répond comme il peut : cela fait plusieurs millions d'années ! Il a souvent mal compris, y compris dans l'Ancien Testament et probablement partiellement dans le Nouveau Testament, mais pourquoi la tradition catholique serait-elle infaillible : ses concepteurs n'ont-ils pas eu la liberté de se tromper ?
Il est des questions dont la raison admet qu'elle ne peut recevoir de réponse sans qu'elle soit heurtée (la création est le fait de Dieu, mais d'où vient-Il ? ou le libre-arbitre ou l'immortalité de l'âme), d'autres méritent d'être argumentées même si c'est d'avouer que l'on n'en sait rien et que l'on est alors, jusqu'à preuve du contraire, dans la partie volonté de la Foi.
Pour la cohérence, je demande que l'on explique comment la théologie concilie le péché originel, source de la concupiscence-tentation, et la liberté de Marie (je ne doute pas de cette dernière puisqu'elle est une conséquence de l'Amour), mais l'autre versant … Jésus l'a-t-il évoqué ?
Des adultes ne doivent pas hésiter à s'aventurer aux franges de la connaissance, là où l'on frôle l'inconnu, le nouveau, … (la périphérie ?) : il ne se comporte pas en naïf enfant.
Tradition : sens et facettes
- Détails
- Version n° 7 du 21-10-2024
Le pape François a comparé la tradition aux racines d'une plante. Elles continuent de croître au fil du temps, de même que la tradition s'enrichit de nouvelles compréhensions.
Il y a aussi des radicelles qui meurent sans remettre en cause la vigueur et la pérennité de l'arbre : la Tradition fait-elle de même ? N'a-t-elle pas tendance à transformer une interprétation d'un moment en un carcan pour le futur ?
Elle peut aussi être comparée à une ancre flottante qui ralentit l'évolution sans l'empêcher et limite les changements de direction brutaux. Le pire, c'est lorsqu'elle arrive à se comporter comme une ancre de fond qui immobilise complètement … jusqu'à une tempête qui arrache tout !
La tradition peut aussi être considérée comme une force qui puise son énergie (un peu analogue à l'énergie sombre qui dilate l'univers) dans ce que le passé a accumulé pour nous projeter dans l'avenir afin d'y découvrir des nouveautés immanentes ou transcendantes.
La tradition peut aussi être vue comme un tremplin qui permet, en tirant des leçons du passé, de se projeter plus loin dans le futur.
Finalement, je souhaite que la tradition se comporte comme un pilote automatique qui permet, sans ralentir la progression du bateau, de garder le cap par une adaptation de l'orientation du gouvernail en fonction des perturbations du moment.
On n'a jamais fini de découvrir Dieu, ayons bien conscience que notre intelligence peut se tromper … même lorsqu'elle croit écouter le Paraclet : notre audition n'est pas toujours bien fiable. Evitons d'asséner des certitudes.
Dogmes ambigus
- Détails
- Version n° 10 du 08-10-2024
Utiliser un langage ouvert ou poétique pour essayer de faire percevoir un aspect de la divinité est pertinent, mais lorsqu'on veut décrire une vérité …
En résumé : certains dogmes sont contestables pour diverses raisons.
- Les scientifiquement erronés : le péché originel basé sur l'apparition de la mort avec la faute d'un premier homme …
- Les illogiques : Jésus pleinement homme, mais sans père biologique.
- Les autoproclamés : infaillibilité pontificale ou des conciles, fruit du "charisme particulier" des évêques.
- Les fragiles : Immaculée Conception qui évite la concupiscence à Marie.
Loi de Dieu ou de la république ?
- Détails
- Version n° 7 du 08-10-2024
Dans l'affirmation que la loi de Dieu ne peut pas être au-dessus de celle de la république, n'y a-t-il pas un mal entendu ?
La loi de Dieu est d'aimer et cela n'est ni au-dessus ni au-dessous des lois républicaines, c'est dans un autre domaine. Il serait peut-être plus juste de parler d'Appel de Dieu à l'Amour plutôt que de loi qui respecte nettement moins bien la liberté conséquence de cet Amour …
Pour les chrétiens, il ne doit pas y avoir de gros problèmes, mais il est vrai que la charia peut rencontrer des difficultés avec la laïcité.
De son côté, le secret de la confession est un problème. Dans l'Evangile de St-Jean qui instaure le pardon des péchés, le secret n'est pas évoqué : c'est l'église qui l'a imposé rapidement semble-t-il. N'est-ce pas plus une sage règle disciplinaire de l'église plutôt qu'une loi divine ?
Arrêt de la vie et résurrection
- Détails
- Version n° 8 du 11-10-2024
Lors de l'arrêt de la vie – la mort – l'organisme cesse de puiser dans son environnement énergie et matière pour se maintenir vivant. Sa propre matière devient alors une ressource pour d'autres organismes vivants ou un simple écroulement de molécules trop complexes et en contradiction avec le deuxième principe de la thermodynamique.
Cet arrêt de la vie se fait d'abord au niveau de l'individu lui-même, puis à celui des organes, enfin des cellules. Certains de ces organes peuvent survivre longtemps lors d'une greffe et je me demande pourquoi certaines cellules, lors du processus dit de décomposition, ne pourraient pas s'incorporer tel quel dans d'autres organismes vivants.
Cette décomposition est habituellement dénommée corruption des corps et perçue comme une horreur, une déchéance, voire une punition : c'est une erreur ! Il s'agit de la simple poursuite de l'évolution de l'univers vers plus de stabilité thermodynamique à laquelle la vie est un défi.
Les molécules qui forment le corps-matière d'un être humain n'ont rien de spécifique. Il s'en accumule lors de la croissance de l'enfant, il s'en disperse tout au long de la vie. Les molécules font temporairement partie d'une architecture qui présente les caractéristiques de la vie, mais elles-mêmes ne le sont pas.
Le corps ressuscité de Jésus ou de Marie (lors de ses apparitions) ne semblent plus formés de molécules, mais constitués d'une autre substance qui peut se rendre perceptible d'une manière sélective, apparaître dans des espaces clos, ne pas être reconnaissable, …
Lors de la transfiguration, Moïse et Elie semblent déjà disposer de leur corps ressuscité : faut-il comprendre que la venue de Jésus dans la gloire, se situant au-delà du temps et de l'espace, se produit pour chacun au moment de sa mort ? N'en sera-t-il pas de même pour nous ?
Pour la disparition du corps "moléculaire" de Jésus, voire de Marie, faut-il imaginer un processus inexpliqué de dispersion accélérée de leurs corpuscules dans le milieu environnant ?
On se félicite lorsqu'un saint ne connait pas la putréfaction, mais est-ce ainsi qu'il faut imaginer la résurrection ?