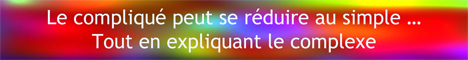Anecdotiquement, lorsque je rencontre un manager persuadé qu'il doit trimer pour augmenter le profit fait par son entreprise, je lui propose de demander une réduction de sa rémunération, ce qui augmentera d'autant ce résultat … cela le conduit généralement à se poser des questions.
Obéissance
- Détails
- Version n° 6 du 04-10-2024
Plusieurs moines et moniales ont eu l'occasion de me confier que, pour eux, le vœu le plus difficile à supporter est celui d'obéissance.
Certes, au moins pour les bénédictins et analogues, est-il précisé que c'est "selon la règle de St-Benoit", mais j'entends aussi souvent qu'il faut en conséquence renoncer à sa "volonté propre".
Le bon fonctionnement d'une communauté demande un minimum de discipline, mais s'en remettre totalement à un supérieur qui n'est qu'un humain me parait excessif. Le souci de trouver une solution acceptable est heureusement pour beaucoup de supérieur(e)s le chemin emprunté, mais le danger d'abuser de la règle existe trop souvent.
On sait à quel point cet engagement peut conduire à des dérives et je préfère la manière dont, dans le mariage, cette nécessité est exprimée par la notion "d'assistance en toutes circonstances". Les concessions que l'on est conduit à accepter en couple sont aussi des "renoncements à la volonté propre", mais formulées d'une manière égalitaire, positive et non hiérarchique, négative.
Dans le mariage, il n'y a pas d'engagement d'obéir à l'autre même si, dans la pratique, cela se produit.
Il y a potentiellement, dans certaines perceptions de l'obéissance, l'acceptation de renoncer à l'épanouissement de ses talents. Il faudrait que ce soit le hiérarchique qui se voit imposer le devoir de rechercher l'épanouissement du subordonné (j'introduisais dans les définitions de fonctions en entreprise, le devoir de "transformer en compétences les aptitudes des collaborateurs").
Ici aussi, une évolution des comportements dans l'église est nécessaire : il faut se libérer d'une attitude un peu servile du rapport hiérarchique.
Profit
- Détails
- Version n° 8 du 12-10-2024
Une fondation du capitalisme est de proclamer que la finalité de l'entreprise est de "faire du profit" avec, pour certains, la perversion supplémentaire qu'elle doit maximiser les versements à l'actionnaire. C'est de ce paradigme qu'il faut sortir.
En fait, la vraie finalité de l'entreprise n'est pas de faire du profit, mais de créer de la richesse, de la valeur à partir des moyens dont elle dispose : personnel et capital.
A l'issue de la création de la richesse, se pose le problème de son partage entre les acteurs : fournisseurs, salariés, actionnaires, état, clients, autres environnants, …
Dans le système capitaliste, le principe est que chacun essaye d'en tirer le plus qu'il peut et que l'actionnaire décide de l'attribution de ce qui reste … ce qui lui permet alors de tirer la couverture à lui au besoin par l'intermédiaire d'une direction générale qu'il domine via le conseil d'administration qu'il nomme.
L'avantage du capitalisme est qu'il pousse à la performance (efficacité et efficience) par l'aiguillon de la concurrence (ce qui manquait, manque encore trop souvent, dans le monde fonctionnarisé). L'autorité qui doit veiller au respect de l'intérêt général ou commun, doit y mettre des garde-fous, mais comment faire lorsque l'entreprise est multinationale ?
Le capitalisme financier devrait être encadré (mais comment ?) tout en maintenant son rôle de régulateur des cours. Il n'est pas créateur de richesse lorsqu'il ne joue que sur les différences de cours de bourse, mais il a aussi un aspect plus néfaste lorsqu'il prend le pouvoir dans une entreprise avec le seul objectif de lui pomper le sang (ses réserves) voire de l'endetter pour verser des dividendes quitte à la pousser à la faillite en laissant l'ardoise à d'autres.
J'ai beaucoup prêché à mes ouailles que pour réussir, il fallait non pas plumer ses clients, mais les aider à s'enrichir, que le défi n'était pas de leur vendre sa camelote, mais de le convaincre de l'acheter : un renversement de perspective.
Hommes et autres êtres vivants
- Détails
- Version n° 8 du 12-10-2024
L'homme est-il différent des animaux par nature ou par degré ?
Hindouisme, jaïnisme, bouddhisme, sikhisme, taoïsme, confucianisme, islam, … considèrent que l'homme fait totalement partie de la nature et ne diffère des animaux que par le degré de sa conscience. Ces derniers ont une âme (anima) comme les hommes ou les plantes.
Le christianisme pense que l'homme a une âme qu'il confond habituellement avec l'esprit. Il y a un mélange entre l'âme-anima qui pilote sa vie terrestre et l'âme-esprit immortel.
L'incarnation de Dieu en Jésus-Homme me semble la raison qui peut justifier de considérer l'homme comme d'une nature différente des animaux.
Dieu Fils est un être spirituel. C'est son Esprit qui s'est incarné dans Jésus enfant. Au plus intime de Jésus homme, on trouve son esprit humain lié à l'âme que Dieu donne au sapiens avec la vie dotée du libre arbitre.
Faut-il penser que l'Esprit de Dieu Fils a cohabité, en symbiose, avec l'esprit humain de Jésus en son plus intime ?
L'un ou l'autre s'exprime-t-il selon les situations : faim ou angoisse versus miracle ?
Je me demande s'il ne faut pas regarder notre incarnation (avec les propriétés associées) comme une simple différence de degré et notre fin-dernière qui est de vivre de l'Amour même de Dieu comme d'une nature différente déjà présente ici-bas sous la forme de l'esprit permettant l'exercice d'une spiritualité sous le "souffle" discret du Paraclet.
L'octroi du libre arbitre réservé ici-bas au sapiens est, au moins pour moi, la différence essentielle.
Ne faut-il pas en déduire que seul l'être humain est doté d'un Esprit ? Je le crois, mais je ne peux le prouver …
Homininés et sens de Dieu
- Détails
- Version n° 6 du 10-10-2024
Je pense que, pendant les quelques millions d'années qui ont précédé l'Incarnation de Jésus, les hommes, depuis les premiers homos, ont cherché à percevoir la cause de leur existence, aidé par le Paraclet. Leur réponse s'est souvent concrétisée dans des éléments matériels (totems, veau d'or, … ) puis des dieux, images de l'homme (grecs ou romain) puis avec le peuple juif, un Dieu unique et transcendant, mais à la fois plein de tendresse et de fureur : une recherche à tâtons.
Jésus est venu préciser que Dieu Père n'est qu'Amour pour les hommes. Lui-même ne s'est pas clairement déclaré Dieu Fils. Il s'exprime maintenant par l'Esprit Saint, le Paraclet.
Notre foi est de croire cela tout en continuant de chercher à mieux "percevoir" Dieu. Il nous faut comprendre de moins en moins mal le message du Christ et que tombent des erreurs que l'église au cours des siècles précédents a validé comme le recours à la violence pour imposer ses dogmes : Dieu continue de se révéler par inspiration du Paraclet.
Raison et théologie
- Détails
- Version n° 4 du 22-03-2024
Puisque la théologie ne doit pas être en contradiction avec la raison et que la science est le fruit de l'exercice de cette raison, la théologie commence, alors, lorsque la science s'arrête … souvent provisoirement
Si raisonner "en terme scientifique" signifie conduire les réflexions avec la rigueur de l'épistémologie, alors il faut le faire. S'il s'agit de penser que la science va pouvoir répondre aux questions fondamentales de la théologie, il faut crier halte-là !
Il n'y a pas superposition des deux disciplines, mais juxtaposition.
Le propre d'une création est de se réaliser à partir de rien. Dans l'état actuel des connaissances, les constituants du Big Bang ne sont apparus à partir d'aucun préexistant … sinon Dieu-Père par Dieu-Fils (encore que cette intermédiation reste bien mystérieuse pour moi : je n'ai pas le souvenir que Jésus l'ait revendiquée).